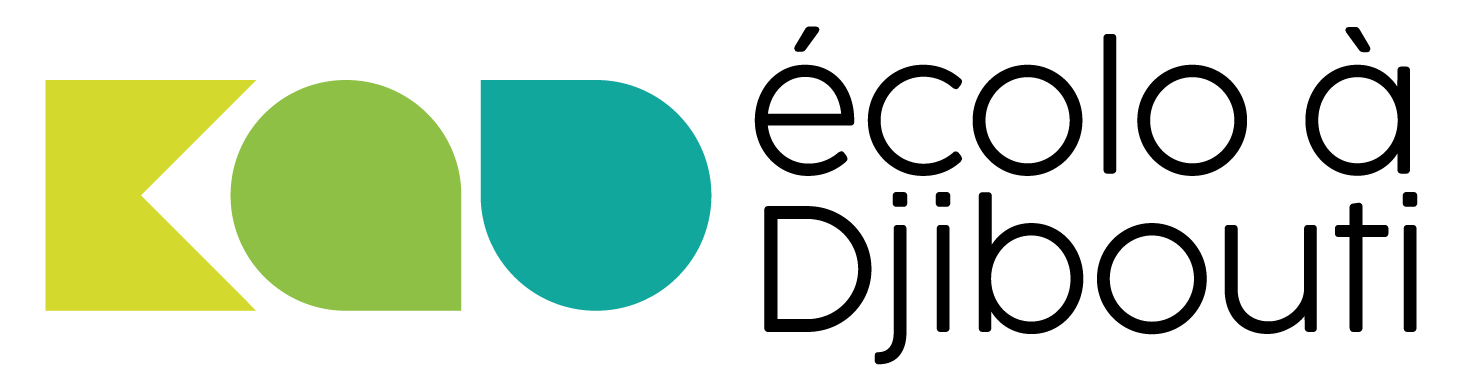par Amina Idan Paul | Oct 13, 2024 | Climat, Éducation
La Journée d’action pour l’adaptation climatique des jeunes a été célébrée le 12 octobre 2024. Des événements locaux se sont tenus à travers tout le continent africain, grâce à l’engagement du Global Center on Adaptation (GCA) et de l’African...

par Amina Idan Paul | Mai 11, 2024 | Éducation, Environnement
Alors que le mois de mai débute à Djibouti et que les premières vagues de chaleur commencent à se faire sentir, certains ironisent déjà sur le réchauffement climatique. Ils font l’erreur, intentionnelle ou non, de confondre météo et climat. Mais où se situe exactement...

par Amina Idan Paul | Oct 5, 2022 | Innovation
Il est possible de faire pousser des plantes sans terre. Celle-ci est alors remplacée par un substrat neutre (billes d’argile, sable, feutre horticole…), voire même par de l’eau. C’est ce qu’on appelle l’hydroponie ou hydroculture. Mohamed Houmed...

par Amina Idan Paul | Juin 20, 2022 | Climat
Depuis plusieurs mois, l’Afrique de l’Est, et plus précisément certaines parties de la Somalie, de l’Éthiopie et du Kenya, sont exposées à une sécheresse hors-norme. Des températures records et des conditions extrêmes qui n’ont cessé de s’aggraver au cours de ces...

par Amina Idan Paul | Oct 13, 2021 | Activisme
Alors que l’Afrique n’est responsable que de 4 % des émissions mondiales, elle est pourtant disproportionnellement affectée par le changement climatique, menaçant la vie des populations sur place. Aucune région n’est épargnée par des phénomènes météorologiques de plus...