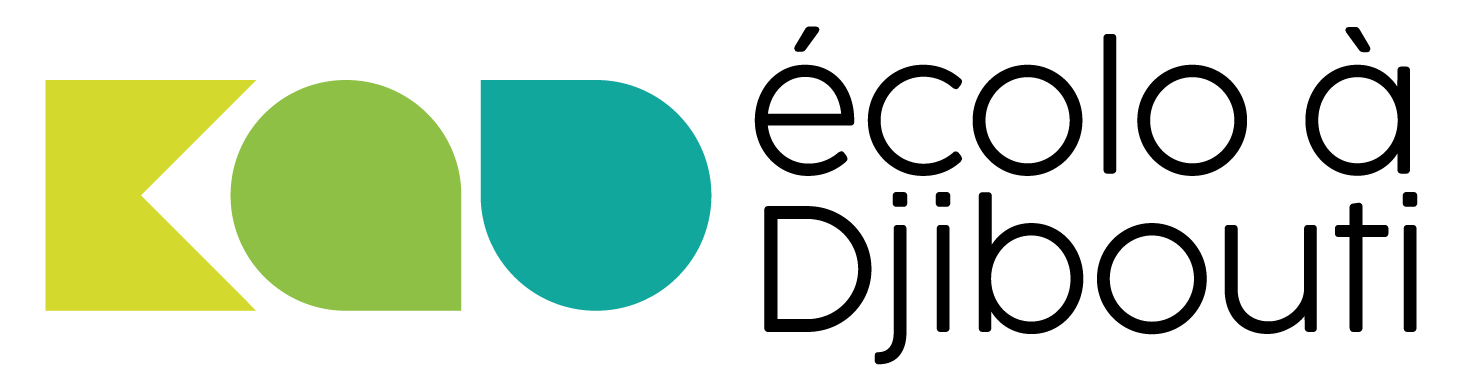par Amina Idan Paul | Fév 17, 2025 | Éducation
Le dimanche 16 février après-midi, l’association Écolo à Djibouti a eu le plaisir de participer à un moment riche en découvertes et en échanges autour du recyclage, en compagnie des jeunes membres des clubs environnement du lycée et de l’université. Cette...

par Amina Idan Paul | Oct 13, 2024 | Climat, Éducation
La Journée d’action pour l’adaptation climatique des jeunes a été célébrée le 12 octobre 2024. Des événements locaux se sont tenus à travers tout le continent africain, grâce à l’engagement du Global Center on Adaptation (GCA) et de l’African...

par Amina Idan Paul | Juin 8, 2024 | Activisme, Environnement
En célébration de la Journée mondiale de l’environnement, l’association Ecolo à Djibouti a procédé à une plantation d’arbres dans la cour de l’Observatoire Régional de Recherche pour le Climat (ORREC). L’événement, tenu le jeudi 6 juin...

par Amina Idan Paul | Mai 23, 2024 | A la rencontre de
Au cœur des jardins d’Ambouli, véritable poumon vert de Djibouti-ville, nous avons rencontré Anwar, un jardinier passionné par la terre. Dans son jardin familial, Anwar persévère dans son métier et sa passion malgré les nombreuses difficultés. Découvrez son...

par Amina Idan Paul | Mai 19, 2024 | Activisme, Éducation
« Gardons les mains dans la terre et le cœur connecté à la nature » : telle était la philosophie incarnée lors de ce deuxième atelier « Mon Potager à Djibouti ». Pourquoi ? Parce qu’il a eu lieu au cœur même du poumon vert de la ville, dans les jardins...