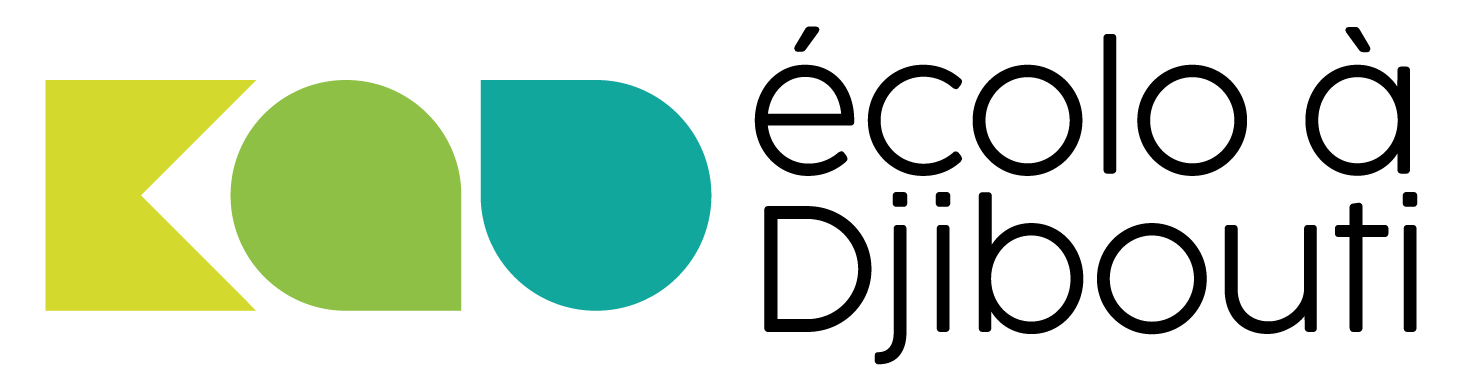Dans une société où tout se jette, le problème des déchets prend de plus en plus de place. Ces ordures polluent considérablement nos écosystèmes et peuvent même, dans certains cas, être une menace pour notre santé. Mais face à ce constat, un jeune entrepreneur djiboutien pourrait avoir trouvé la solution à ce problème pour Djibouti.
Une machine qui transforme les déchets en cendres
Finaliste de la première édition du concours d’entrepreneuriat D-Startup organisé par le Fonds Souverain de Djibouti, Abdillahi Ahmed est un jeune entrepreneur djiboutien déterminé, prometteur et rempli d’ambitions. A tout juste 25 ans, il a déjà fondé sa startup Zeta Corp avec une idée bien en tête : celle de révolutionner le traitement des déchets à Djibouti. Pour y parvenir, il compte sur une drôle de machine baptisée ASHER qui promet de réduire les déchets solides en cendres sans les brûler.
« Les déchets ont longtemps été un problème à Djibouti mais aussi en Afrique. Nous brûlons et jetons nos déchets un peu partout. Je veux offrir une alternative à ce problème avec le ASHER » dit-il.
Comment fonctionne-t-il ?
Le ASHER est un petit appareil de 6 mètres de haut qui peut réduire la plupart des déchets solides en cendres, à l’exception du verre et des métaux. En quoi alors cet appareil est-il différent d’un incinérateur lambda puisqu’il y’a production de cendres et donc combustion ? Pour répondre à cette question, il a fallu nous replonger dans nos livres de chimie.
Lorsque les déchets sont mis dans l’Asher, ils finissent dans la chambre de dégradation thermique. Sous la chaleur extrême de la chambre (jusqu’à 1000°C), ils se décomposent via le processus de pyrolyse. Pour rappel, la pyrolyse c’est lorsqu’une substance se décompose sous l’action de la chaleur et sans autres réactifs.
La chaleur générée par le processus est maintenue uniquement à l’intérieur de la chambre. Ainsi, plus la machine fonctionne longtemps, plus la température interne sera élevée. Ce n’est donc pas une combustion mais une décomposition chimique qui détruit les déchets dans l’ASHER. Il en résulte alors des cendres et de petites quantités de gaz. Des cendres qui mélangées à de la sciure de bois peuvent devenir de l’engrais organique, nous a expliqué Abdillahi. Elles sont non dangereuses et conformes aux normes de l’Agence américaine de protection de l’environnement, a-t-il ajouté. Si celles-ci ne peuvent pas être transformées en fertilisant à cause de la nature des déchets traités (par exemple : les couches, les plastiques), les cendres peuvent être utilisées à d’autres fins, comme pour la fabrication de pavés destinés à l’aménagement paysager. Un moyen de valoriser le contenu de nos poubelles.
La machine produit 4 % de son poids d’origine sous forme de cendres donc pour 1000 kg de déchets, nous n’obtiendrons que 40 kg de cendres. Les 5 à 6 % restants sont des déchets non gérables, qui comprennent les déchets métalliques, céramiques et de béton.



Le ASHER nous vient tout droit de Malaisie et a été mis au point par Roland TEE. En 2010, à la retraite après toute une vie à travailler dans l’industrie de l’eau, ce sexagénaire malais, a décidé d’apporter une solution à la problématique de traitements des déchets dans dans sa ville. Après des dizaines de prototypes, il met alors au point le ASHER.
C’est en 2019, alors étudiant en Business Management que dans ce pays, que Abdillahi fait la connaissance de Roland TEE et de son associé Pang. Une belle rencontre qui a débouché deux années plus tard sur un partenariat prometteur, car Zeta Corp est aujourd’hui le référent exclusif de la marque en Afrique.

Une machine respectueuse de l’environnement ?
Des gaz inoffensifs
A Djibouti, on produit par jour, 300 tonnes de déchets organiques et inorganiques qui finissent en grande majorité au centre d’enfouissement de Douda. Mais au niveau mondial, l’incinération reste le mode majeur de traitement des déchets. Une pratique toujours controversée car accusée de diffuser des substances polluantes dans l’environnement avec des effets néfastes sur la santé humaine.
Contrairement aux incinérateurs, l’ASHER promet un procédé respectueux de l’environnement. D’après l’inventeur malais, les gaz produits à l’issue du processus de pyrolyse sont neutres et inoffensifs. Pour cause, la machine possède un système de filtration de l’eau pour empêcher les émissions toxiques résultant de ce processus, d’être rejetés dans l’atmosphère. Le ASHER dispose à ce jour de plusieurs rapports d’essais d’organismes de vérification qui attestent de la sûreté de l’appareil pour la santé et l’environnement.
Aucune énergie pour fonctionner
L’autre avantage nous a précisé Abdillahi est que comparé aux qui utilisent du carburant comme le diesel pour brûler les déchets, le ASHER n’a besoin d’aucune énergie à l’exception d’un petit feu pour démarrer. La chaleur créée est alors stockée dans les parois de l’appareil, faisant monter la température à l’intérieur et créant l’effet pyrolyse qui réduit en cendres les ordures. La décomposition des matières libère encore plus de chaleur, qui stockée de nouveau dans les murs, augmente la température dans l’appareil…un cycle se met en place. Tant que la machine est alimentée en déchets, elle continue alors de fonctionner sans électricité, ni gaz, ni carburant.
Pour les besoins primaires (ventilateur, tableau d’affichage), l’électricité produite à partir des panneaux solaires intégrés est plus que suffisante, ce qui permet au Asher de continuer à fonctionner même sous la pluie ou de faible ensoleillement.
Dresser un mur contre les pollutions
Nous produisons actuellement dans le monde en moyenne 2 Milliards de tonnes de déchets par an. Une production sans cesse plus importante avec des impacts sur notre environnement et notre santé. Djibouti n’échappe pas à la règle. Des centaines de milliers de tonnes d’ordures ménagères y sont produites par an. Des déchets qu’il importe de collecter, de transporter, de stocker et de traiter.
Là où la machine de Zeta Corp est intéressante, c’est qu’elle est mobile.
« Le ASHER va là où il y’a les déchets, c’est un gain de temps et d’argent » nous explique Abdillahi, le dirigeant de Zeta Corp. Sa fonction portative permettrait donc à la machine d’être disposée un peu partout : aux environs des marchés, des villes, dans les zones rurales, les terrains difficiles, les parcs nationaux. Placée près des décharges, elle éviterait les incinérations à ciel ouvert de déchets, responsables de pollution atmosphérique.
Et bien évidemment lorsqu’on parle de déchets, impossible de ne pas mentionner la pollution plastique qui empoisonne la planète toute entière. A Djibouti, les sacs plastiques sont monnaie courante et se retrouvent facilement jetés dans la nature ou dispersés à chaque coin de rue. Bouteilles , plastique, caoutchouc, tubes et pneus, déchets mixtes, le ASHER est capable de traiter la plupart des déchets tout en étant respectueux de l’environnement. Un bon moyen pour réduire la pollution plastique générée dans le pays. C’est le défi que Abdillahi Ahmed et sa jeune startup Zeta Corp ont décidé de relever à Djibouti.
Un projet prometteur à suivre !