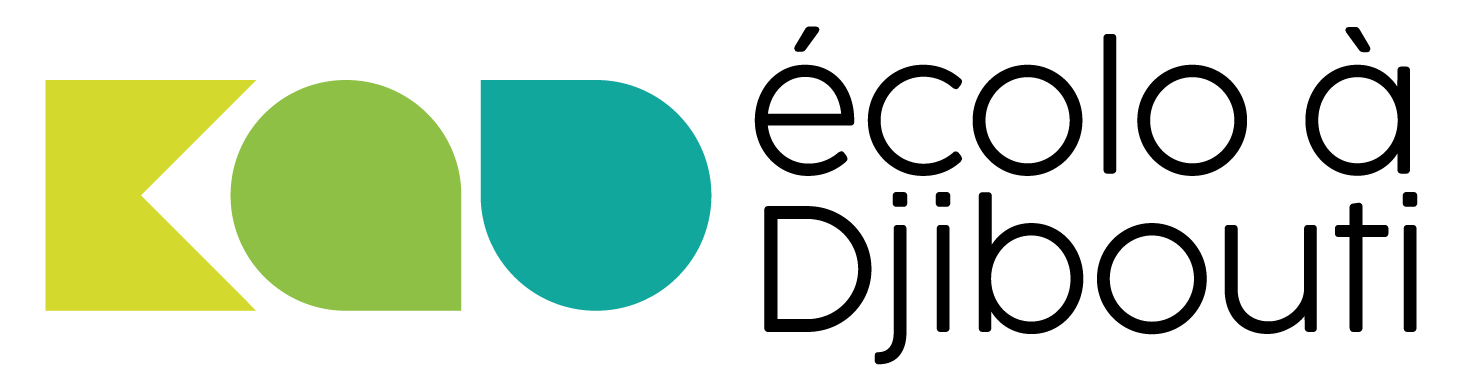par Amina Idan Paul | Mai 23, 2024 | A la rencontre de
Au cœur des jardins d’Ambouli, véritable poumon vert de Djibouti-ville, nous avons rencontré Anwar, un jardinier passionné par la terre. Dans son jardin familial, Anwar persévère dans son métier et sa passion malgré les nombreuses difficultés. Découvrez son...

par Amina Idan Paul | Avr 27, 2022 | A la rencontre de
A l’occasion des jeux internationaux de la jeunesse, Écolo à Djibouti a participé au côté de l’association sportive du Lycée Français à Djibouti à une journée de nettoyage de lycée et de la plage, le 26 avril 2022. Les lycéens ont d’abord commencé la journée par le...

par Amina Idan Paul | Mar 8, 2022 | A la rencontre de
Pour célébrer le 8 mars, la journée des droits des Femmes, Ecolo à Djibouti met à l’honneur les femmes de l’ombre, celles que l’on croise au quotidien et dont on ne parle jamais. Il est 21h du soir. Depuis la route de Venise, plusieurs silhouettes se distinguent. Une...

par Amina Idan Paul | Fév 27, 2022 | A la rencontre de
Le requin-baleine possède jusqu’à 300 rangées de dents. Mais nul besoin de s’inquiéter ! Malgré sa taille imposante, il est pacifique et inoffensif pour l’Homme. Un géant inoffensif Chaque année, la baie de Ghoubet à Djibouti, est le théâtre d’un...

par Amina Idan Paul | Fév 21, 2022 | A la rencontre de
Des jardins et des balcons fleuris à Djibouti ?! Impossible me diriez-vous ? C’est aussi ce que je pensais jusqu’à ce que je découvre la page Facebook “Jardiniers amateurs à Djibouti”. Que ce soit pour le plaisir ou pour s’en nourrir, ces jardiniers ont placé l’amour...

par Amina Idan Paul | Nov 1, 2021 | A la rencontre de
Dans une société où tout se jette, le problème des déchets prend de plus en plus de place. Ces ordures polluent considérablement nos écosystèmes et peuvent même, dans certains cas, être une menace pour notre santé. Mais face à ce constat, un jeune entrepreneur...