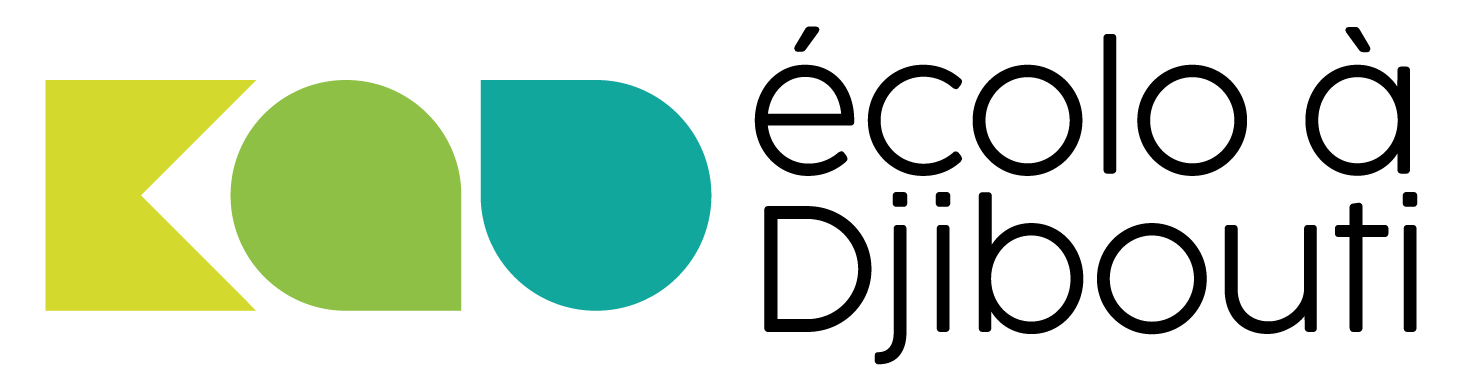par Amina Idan Paul | Juin 8, 2024 | Activisme, Environnement
En célébration de la Journée mondiale de l’environnement, l’association Ecolo à Djibouti a procédé à une plantation d’arbres dans la cour de l’Observatoire Régional de Recherche pour le Climat (ORREC). L’événement, tenu le jeudi 6 juin...

par Amina Idan Paul | Mai 11, 2024 | Éducation, Environnement
Alors que le mois de mai débute à Djibouti et que les premières vagues de chaleur commencent à se faire sentir, certains ironisent déjà sur le réchauffement climatique. Ils font l’erreur, intentionnelle ou non, de confondre météo et climat. Mais où se situe exactement...

par Amina Idan Paul | Fév 27, 2022 | Environnement
Pandémie de Covid-19, contexte politique actuel…les négociations en perspective de la cinquième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement n’ont pas fait grand bruit sur la scène internationale. Des pourparlers qui pourraient, pourtant, donner...

par Amina Idan Paul | Fév 18, 2022 | Environnement
Dans une société où tout se jette, les déchets urbains sont un enjeu qui touche à la santé des individus, à leur bien-être mais aussi à l’environnement. Quels dangers potentiels représentent-ils ? Sur l’environnement, sur notre santé ? Tous les jours, on génère de...

par Amina Idan Paul | Jan 30, 2022 | Environnement
Envoyer un mail, faire une recherche sur Google, regarder un film en ligne ou bien surfer sur les réseaux sociaux, tous les jours nous effectuons des actions qui semblent simples et anodines. Mais saviez-vous que ces activités numériques sont très polluantes ? C’est...

par Amina Idan Paul | Déc 21, 2021 | Environnement
Les bâtiments sont un véritable gouffre énergétique dans les pays africains et Djibouti ne fait pas exception à la règle. Avec une urbanisation rapide, les villes africaines ne peuvent plus ignorer la question de la régulation de l’énergie dans le bâtiment. Zoom sur...